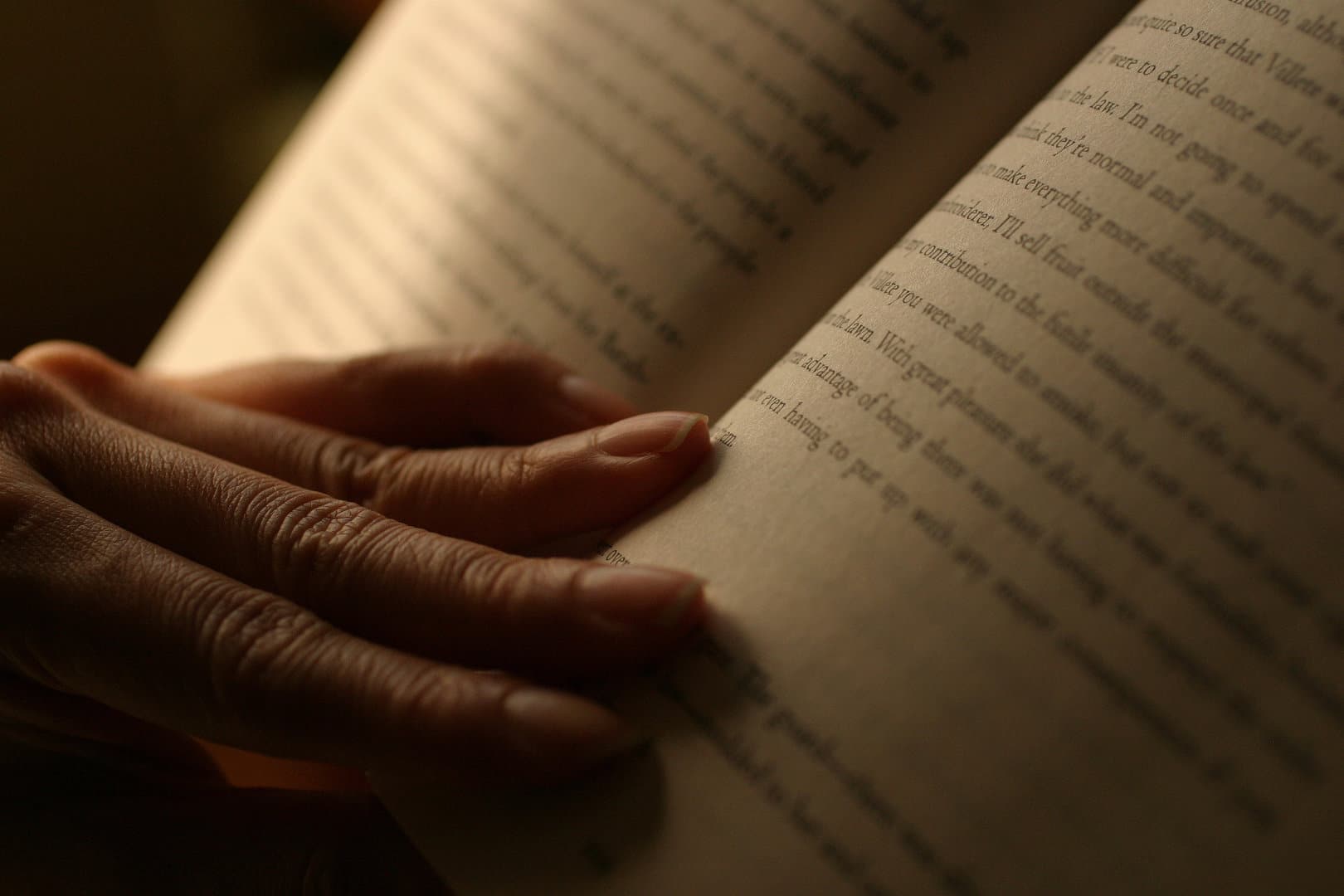Avec ses photographies, Helen Levitt a capturé la délicieuse et franche chorégraphie des rues de New York en 1940, sa ville natale, révélant au grand jour ce que William Butler Yeats appelait la « cérémonie de l’innocence » du quotidien de la Grosse Pomme. Décédée à l’âge de 95 ans, elle a laissé l’image d’une Amérique pauvre, mais bien vivante.
Les rues de New York
De son vivant, Helen Levitt a autorisé peu de publications de ses photographies en ouvrages, comme si elle avait souhaité conserver leur magie interne pour les seuls visiteurs des musées et des expositions.
Solitaire et discrète, Levitt préférait la compagnie de ses chats et la lecture d’un bon livre aux mondanités et au flonflon des vernissages de ses expositions. Elle estimait sans doute que son travail parlait à sa place ; que la chaude émotion de la ville de New York, de sa ville, transparaissait suffisamment dans ses clichés lyriques, mystérieux et sereins, sans qu’elle eût besoin de s’exprimer.
En somme, ses photographies sont restées plus célèbres que celle qui les a faites : enfants qui jouent sur les trottoirs, femme coiffée de bigoudis qui bouquine un magazine télé, type en short de bain et canne qui attend de traverser la rue, vieux bonshommes qui mangent de la pastèque devant une boutique…
Elle a su, comme personne, témoigner de l’arlequin de la banalité quotidienne, capter les instants d’une vie qui s’installe dans la rue plutôt que dans les appartements, en déployant un univers que n’aurait pas renié Fellini.
Vous pourrez trouver ses photos sur cette page, ou sur celle-ci.
Helen Levitt, autodidacte
Née en 1913 dans le Bronx, à New York, Levitt s’empare seule de l’outil photographique comme l’on se saisit d’une paire de lunettes : pour voir le monde plus net.
Elle abandonne l’école alors qu’elle est en dernière année de lycée et travaille pour un photographe de portraits commerciaux du Bronx, J. Florian Mitchell. Elle aide au développement des photos dans la chambre noire, mais apprend les bases du métier.
Elle entraîne son regard, comme elle le dira plus tard, en parcourant les musées et les galeries d’art : pour apprendre la composition picturale. Levitt partage le point de vue de ses maîtres en photographie : ce métier se nourrit d’intuition. Pour autant, pas question de verser dans le photojournalisme ; elle est trop timide, et n’aime pas la technique, son point faible.
Ses influences sont nourries par Cartier-Bresson, qu’elle rencontre lors de son passage à New York en 1935, et sa façon de capter la vie quotidienne avec grâce ; par Walker Evans et son rapport frontal aux gens ; par Shahn et sa spontanéité.
La vie des trottoirs
C’est en observant les dessins éphémères à la craie, tracés par les enfants des rues de New York, qu’elle a l’idée de les immortaliser sur pellicule : pour rompre avec leur brièveté, justement. Elle abandonne son vieux Voigtländer pour un appareil Leica d’occasion, le préféré de Cartier-Bresson, et prend des clichés de ces dessins, ainsi que des enfants qui les produisent.
Il faudra attendre 1987 pour qu’un ouvrage, In the Street : Chalk Drawings and Messages, New York City 1938-1948, recense les photographies de ses déambulations de cette époque. Il est considéré comme l’un des 100 plus grands livres de photos.
C’est une époque, au tournant des années 30 et 40, où le travail des photographes vise à inspirer des changements sociaux. La Dépression a reculé grâce au New Deal de Roosevelt, mais la pauvreté reste partout présente – d’autant que l’année 1936 a été marquée par une rechute économique.
Levitt se rend dans les quartiers les plus paupérisés de Spanish Harlem et du Lower East Side, où les habitants ont fait de la rue leur maison. Elle n’exprime pas le désir de se faire le témoin de l’Amérique rooseveltienne, mais de montrer que la vie déroule son fleuve tranquille avec une poésie constamment renouvelée, y compris quand la poussière et la saleté la recouvrent.
Entre photographie et cinéma
Fortune Magazine est la première revue à publier ses photos de New York, en juillet 1939. L’année suivante ses clichés d’Halloween sont intégrés à une exposition du Musée d’art moderne ; puis c’est sa propre exposition en 1943, organisée par John Szarkowski.
Levitt s’essaie au cinéma. Luis Buñuel, en exil entre USA et Mexique, l’engage comme monteuse sur des documentaires pour le Musée d’Art moderne.
Avec James Agee, écrivain et essayiste (et surtout scénariste de l’unique film, immense, de Charles Laughton, La Nuit du chasseur), ils réalisent et montent un court-métrage documentaire, In the Street, montré en 1952. Le film est comme une mise en mouvement des clichés poétiques de la jeune femme.
De retour à la photographie pure, elle reçoit en 1959 et 1960 des bourses de la fondation Guggenheim pour prendre des clichés en couleurs des rues de New York. Malheureusement, lors d’un cambriolage, une bonne part de son travail est volé.
Ce qui reste a été publié dans Slide Show : The Color Photographs of Helen Levitt, en 2005. Helen Levitt n’a de toute façon jamais vraiment aimé les couleurs, qu’elle abandonne dans les années 90.
Une carrière discrète mais essentielle
Réputée peu commode, Helen Levitt était une femme, et une photographe, exigeante. En 2007, à l’occasion d’un vibrant hommage qui lui était rendu à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, le galeriste Laurence Miller soulignait à quel point elle était viscérale plutôt qu’intellectuelle.
Reconnaissant l’importance de la chance dans l’art de la photographie – le crédo de son ami James Agee – Levitt a surtout inventé son propre monde en arpentant les quartiers populaires de New York, s’immisçant dans l’intimité paradoxalement publique des habitants, enfants comme adultes.
Et somme toute, lorsqu’elle photographie la solitude des new-yorkais refugiés derrière leurs fenêtres, n’était-ce pas elle-même qu’elle imaginait ainsi, fuyant le monde impitoyable des passants, du trafic et du public ?
Le court-métrage In the Street est visible sur la vidéo suivante :